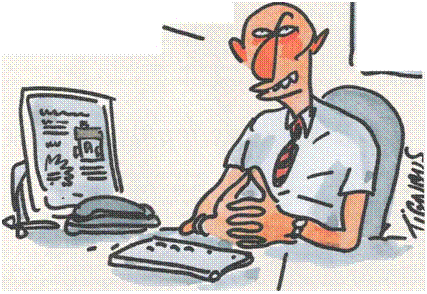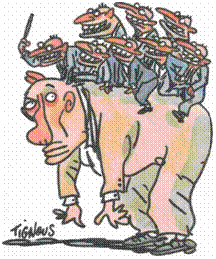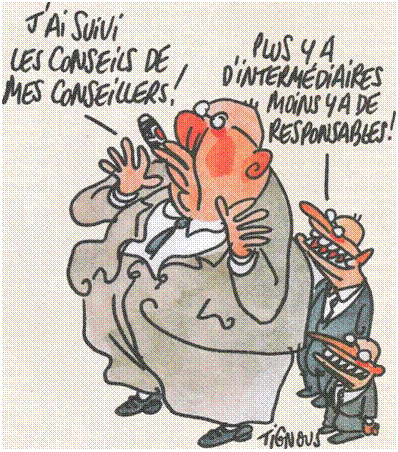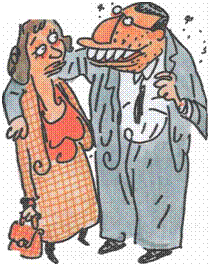Marianne
N°536 / 28 juillet au 3 août 2007
Les
parasites, les profiteurs.
Intermédiaires, professionnels
aux activités mal réglementées, opportunistes divers, ils sont nombreux à
gagner des milliards, dont on se demande s'ils ne participent pas d'une forme
d'enrichissement sans cause.
PAR PIERRE FEYOEL ET ERWAN
SEZNEC
C'est un type, genre cadre supérieur, qui rentre du
Midi à Paris au volant de sa puissante berline (allemande, bien sûr). Il
traverse les causses qui bordent le Massif central. Soudain, au détour d'un
virage, il freine en catastrophe. Un troupeau de moutons a envahi la route.
L'homme a du mal à patienter. Le flot de brebis n'en finit pas de s'écouler. Il
jaillit de sa voiture, se dirige vers le berger et l'apostrophe. « Dites donc, y en a pour
longtemps ?-Bof, encore un quart d'heure environ, répond l'homme avec l'accent rocailleux
du coin. - Faisons
un pari, propose
alors le citadin toujours en quête d'une bonne affaire, je vous dis le nombre exact de
moutons dans votre troupeau et, en échange, vous me donnez un agneau. -Eh
beh... d'accord», répond le paysan. Le Parisien se rue alors sur son ordinateur portable,
pianote frénétiquement pour consulter ses banques de données et lance,
victorieux : « Vous avez 694 moutons. -Ah, ben ça... C'est juste », confirme le berger, éberlué. Et
le cadre sup s'empare d'un animal qu'il jette dans son coffre sans plus de
façon. Mais le gardien du troupeau n'entend pas en rester là. A son tour, il
fait une proposition. «Si je vous dis quel métier vous faites, vous me rendez
mon agneau. Soit, concède le Parisien. - Vous faites le consultant, affirme aussitôt le berger sûr
de lui. - Mais...
comment..., balbutie
l'autre. C'est
simple, lâche
alors le paysan, vous êtes venu sans que je vous demande rien, vous m'avez donné une
information que je connais déjà, et l'agneau que vous m'avez pris... c'est mon
chien ! »
Un secteur florissant
Bien sûr, c'est une blague. Mais le monde de
l'entreprise regorge d'histoires plus ou moins aimables sur les consultants,
leur arrogance, leur inutilité et leurs tarifs prohibitifs : 1500, 2000, 3000 €...
par jour. Parasites, profiteurs, à quoi servent les consultants ? A tout, à
rien, à rassurer les directions générales ? Sur des missions précises, pour des
projets précis, ils semblent quand même avoir leur utilité. D'ailleurs, le
secteur est florissant. En France, il regrouperait quelque 90000 entreprises
pour un chiffre d'affaires annuel dépassant 350 milliards d'euros. Dans cette
galaxie, il y a de tout : des monstres anglo-saxons, de petits cabinets
régionaux ou spécialisés et des individus. Rien de commun entre Ernst & Young,
A.T.Kearney et Price water house Coopers et leurs chiffres d'affaires qui, dans
l'Hexagone, varient entre 440 et 780 millions d'euros, et l'ingénieur licencié
de plus de 50 ans qui décide de faire valoir son expérience en se mettant à son
compte et, dans le meilleur des cas, engrangera bon an mal an quelques centaines
de milliers d'euros d'honoraires. On peut être consultant en tout, sinon en
n'importe quoi : stratégie, management, ingénierie, ressources humaines, marketing,
relations publiques... Les sociétés de conseil en informatique se sont
multipliées ces derniers temps. C'est à la mode. Mais ce sont les armadas des
grands cabinets d'audit financier qui ont le plus fait pour le manque de
popularité du secteur. Imaginez une douzaine de jeunes gens bien mis, mais à
peine aimables, débarquant dans votre entreprise, réclamant tous les comptes,
passant vos activités au peigne fin, étudiant par le menu la rentabilité de
chacun. Ça sent la vente et, derrière, la vague de licenciements. Est-ce le repreneur
ou le vendeur qui a réclamé l'audit ? Peu importe, hélas. Tous ceux qui ont
vécu ces épisodes tragiques de la vie des entreprises, et ils sont des
centaines de milliers en France, gardent du consultant une image pour le moins
désagréable.
Summum de l'irresponsabilité
Dans un autre genre, il ne faut pas oublier le patron
qui s'est cassé la figure et qui, grâce à ses mirifiques indemnités, monte sa
société de conseil. Est-ce sur sa réputation de gestionnaire avisé ? En tout
cas, Jean-Marie Messier, ex-PDG de Vivendi, auteur d'une des plus grandes
déconfitures de l'histoire des affaires françaises, est aujourd'hui à la tête
de Messier Conseil et installé aux Etats-Unis. Et il y a, semble-t-il, du monde
pour profiter de ses avis... Citons, juste pour l'exemple, Philippe Jaffré,
ex-PDG d'Elf de 1993 à 2000, partant lors de la fusion avec Total et remercié
par des stock-options et des indemnités de 200 à 300 millions de francs. Soit,
mais ce n'est qu'une estimation,
autour de 120000 F par journée passée dans le groupe. Aussitôt, il monte une
société de conseil financier qu'il nomme cyniquement Stock-option. Et on ne
saurait oublier AM Conseil, la société d'Alain Mine, grand entremetteur du
capitalisme français, naviguant entre la politique, la finance et les médias.
Chaque client d'Alain Mine, et il en a beaucoup, lui verse 150000 à 200000 €
par an*. Et, à force de vouloir contenter tout le monde, ce consultant de haute
volée s'est, semble-t-il, pris dans des conflits d'intérêts qui ont agacé les
grands seigneurs de la place. Et pour quels conseils d'ailleurs ? C'est à se
demander à quoi servent les dirigeants d'entreprise si leur stratégie doit
Dans la nébuleuse des parasites, le seul moteur est
l'argent. De la rapine occasionnelle au vol organisé.
être initiée
par des tiers. A quoi servent les journalistes sportifs s'ils ont besoin d'un «
consultant » pour commenter le moindre match ? A quoi servent les journalistes
politiques si des politologues viennent à leur place commenter chaque résultat
électoral ? Sans compter les consultants en stratégie militaire et en
terrorisme qui envahissent les médias. Le monde des experts influence, mais il
n'agit pas. Il prétend détenir un savoir, parfois une vérité, mais ne les
confronte jamais au terrain. Et ce summum de l'irresponsabilité est fort bien
payé par ceux-là mêmes qui prennent les risques. Une façon, sans doute, de
conjurer la peur de se tromper.
Dans la vaste population des consultants,
il existe bien sûr de véritables experts dont l'expérience peut être très
profitable à ceux qui les emploient. Mais tout le monde n'est pas ainsi
détenteur d'un savoir ou d'un savoir-faire transmissible. De purs
intermédiaires comme les agents d'artistes, de sportifs vivent de leurs réseaux
qu'ils assurent indispensables à la carrière des stars qu'ils managent. Il y a
pourtant d'immenses vedettes qui se passent de leurs services... Comme les
agents immobiliers ou d'autres peuvent profiter de façon exagérée de la
situation florissante du marché. Tentation discutable, mais après tout
compréhensible.
D'autres sont
moins excusables, comme les syndics de copropriété où les abus sont
systématiques. Le voyage auquel nous vous invitons dans la nébuleuse des
parasites et des profiteurs révèle un univers où trop souvent l'argent paraît
être le seul moteur. Quand ce n'est pas carrément la rapine occasionnelle,
voire le vol organisé • * Petits conseils, de Laurent Mauduit, Stock,
20,99 €.
 Les « coachs». Payez votre manque de
confiance en vous
Les « coachs». Payez votre manque de
confiance en vous
« J’ai un coach... » Et ça,
c'est d'un chic. Cela signifie que vous avez
accédé à un niveau supérieur de responsabilités. Mais aussi que la direction de
votre entreprise estime à un point tel votre potentiel (c'est comme ça qu'on
dit) qu'elle vous a affublé d'une sorte de précepteur qui va vous aider à
assumer avec aisance et efficacité vos nouvelles et hautes fonctions. Cela ne
veut surtout pas dire que, selon ce bon vieux principe de Peter, vous auriez
atteint, voire dépassé, votre niveau de compétence et qu'il faut vous doubler
de quelqu'un qui vous apprenne votre job. Pas de mauvais esprit. Ne vous
dévalorisez pas, ce n'est pas le moment. Autrefois, on appelait ça un tuteur.
Mais cela sentait un peu l'apprentissage, autrement dit le prolo. Coach (prononcez «
cautche » ; « entraîneur », en anglais), c'est plus classe. Cela vous sent la
pelouse du terrain de base-ball, le green du golf, le court du tennis. On est
loin, très loin, du bleu de travail ou de la graisse des machines. Donc votre coach, la plupart
du temps, a été directeur avant vous du même genre de boîte. Il vous reçoit
deux ou trois fois par semaine, vous écoute lui raconter vos problèmes et
comment vous les avez résolus. Il rectifie, conseille, oriente. Une sorte de
psy du pro. Et c'est lui qui dira à votre direction si vous êtes désormais
guéri... pardon, capable de faire le job. Car la direction paie plusieurs
centaines d'euros de l'heure ses prestations. Et si jamais vous ne pouvez plus
vous passer de ce type de relations, sachez qu'il existe des coachs pour tout
désormais, c'est comme les Schtroumpfs. Le coach minceur pour
vous aider à maigrir, le coach relationnel
pour améliorer vos rapports avec vos collaborateurs, votre femme, votre mec,
votre concierge, le coach drague pour
trouver l'âme sœur et même le coach sportif pour
parvenir à la forme idéale, etc. Ceux-là, il vous faudra les payer de votre
poche. Et ils ne sont pas tellement meilleur marché que les coachs
management qui font de vous un vrai chef. Sinon, démerdez-vous tout
seul. C'est bien aussi, c'est moins cher, mais beaucoup moins chic»
Les parasites, les
profiteurs
Agents de
joueurs de foot. L'argent facile
Leur nom claque comme du Gérard de Villiers
(William McKay, Richard Bettoni, Ranko Stojic...), ils portent beau et encaissent
lourd. Dans le football professionnel, les agents de joueurs sont
des incontournables, au sens propre. Impossible de négocier un gros transfert
dans de bonnes conditions sans passer par leur intermédiaire. Leur rôle :
trouver pour les joueurs qu'ils ont en portefeuille les meilleurs contrats, à
la rémunération la plus élevée possible, pour toucher la commission (environ 10 %) la plus
juteuse. Une sorte d'imprésario. Si rien ne permet de les présumer
collectivement malhonnêtes, les méthodes de travail de certaines stars de la
profession ont tout de même paru un peu brumeuses aux enquêteurs de la division
nationale des investigations financières. Ils ont ainsi perquisitionné chez
plus d'une dizaine d'agents ces dernières années, notamment dans le cadre d'une
enquête sur les transferts douteux du PSG. De montages complexes en
domiciliations exotiques, on voit mal en effet ce qui justifie le montant
astronomique de certaines commissions. Le procès des comptes de l'Olympique de
Marseille, qui s'est tenu l'an dernier, a mis en évidence une quinzaine de
transferts portant sur 28 millions d'euros, dont une bonne part de «
commissions d'agents ». Evidemment, si ces intermédiaires empochaient
réellement ces millions d'euros pour un travail relativement bénin de mise en
relation de joueurs et de dirigeants de club, ils mériteraient un Oscar du
parasitisme. En réalité, toutes les investigations montrent qu'une partie de
l'argent des commissions est discrètement rétrocédée aux clubs ou aux joueurs.
Fichu métier... •
Editeurs
de musique. Drôle de partition
C'est une niche juridique, un métier
discret, mais qui fait râler depuis déjà un moment dans le landerneau musical.
Les éditeurs de musique auraient la vie un peu trop facile. A l'origine, ils
éditaient les partitions papier et les distribuaient dans les librairies et
kiosques spécialisés. Ils avançaient des fonds, prenaient des risques
financiers et étaient rémunérés en conséquence. Aujourd'hui, l'édition
est totalement automatisée et le
métier radicalement différent. Les éditeurs n'en continuent pas moins de
percevoir un pourcentage significatif des recettes de l'industrie musicale, sous
forme de droits de reproduction et de droits de représentation. Beaucoup font
en outre signer aux auteurs des contrats qui les lient pieds et poings.
L'avocat spécialisé Roland Lienhardt levait le lièvre dès 1998 dans un livre
fort bien
documenté (Cultivez-vous,
il m'en restera toujours quelque chose, éd. Leader Music). Plus récemment,
le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac) est monté au
créneau. Mais il s'attaque à forte partie. Les éditeurs sont en effet bien
représentés dans les instances professionnelles, à commencer par la fameuse
Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).
Agences immobilières.
Le terrain de tous les abus
Ce n'est un secret pour personne, les prix de
l'immobilier ont pratiquement doublé en moins de dix ans dans la plupart des
grandes villes françaises, mais aussi dans nombre de départements ruraux.
Calculées en pourcentage du prix de vente (5,09 % du total pour de l'ancien,
19,6 % de TVA pour du neuf), les taxes liées aux transactions ont suivi la même
pente, à quelques correctifs près. Communément appelée « frais de notaire », la
plus grande partie de cette somme d'argent ainsi collectée ne fait que passer
dans la caisse de l'étude, pour finir dans celle de l'Etat et des collectivités
territoriales. Il serait donc abusif de considérer les frais de notaire comme
du parasitage, les notaires agissant comme officiers publics. Il en va tout
autrement des agents immobiliers (casquette que certains notaires coiffent
volontiers), qui continuent à réclamer 8 %, voire 10 % de frais d'agence pour
un travail qui devient ridiculement facile. « Cette commission était justifiée
quand les biens restaient un an, deux ans en agence, avec des visiteurs qui
hésitaient, revenaient, tergiversaient, admet un expert de la Fnaim (Fédération nationale des
agents immobiliers). Mais aujourd'hui, n'importe quel deux-pièces à prix à peine
raisonnable part en deux visites à Aix, Lyon ou Nice, sans parler de Paris et
de la petite couronne. A10% sur
150000€, un agent empoche 15000€ dans la matinée. Indéfendable ! » Et le même de suggérer un
niveau honnête pour les commissions d'agence, du moins franciliennes : «Il faut être raisonnable ; 2,5
%, ou le marché du particulier au particulier va nous marginaliser. » Ce discours passe mal. Des
agences parisiennes jouent sur des peurs malsaines, en distribuant dans les
boîtes aux lettres des prospectus intitulés : « Etes-vous prêta ouvrir votre
porte à des inconnus ? », comme si un psychopathe se cachait derrière chaque
candidat à l'achat... Sans parler de cette agence du XVIIe
arrondissement de Paris qui a demandé à un stagiaire, étudiant en intelligence
économique, de faire circuler, via les forums Internet, des histoires à faire frémir sur
les négociations entre particuliers et sur les agences concurrentes... •
Expertises immobilières.
Des certificats d'un sérieux problématique
Pas de vente aujourd'hui d'un
bien sans diagnostic amiante, plomb, gaz, certificat termites et xylophages.
Certes, ils ne sont pas toujours systématiques. Le diagnostic plomb concerne
seulement les immeubles construits avant 1948 et le certificat termites est
imposé ou non par un arrêté municipal. Il devient tout de même difficile d'y
échapper. Des sociétés spécialisées proposent donc des « packages certificats »
à 200 ou 250 €. De l'argent facilement gagné, parfois jusqu'à l'absurde. Les
professionnels qui couvrent un quartier bien délimité reviennent parfois
plusieurs fois par mois dans le même immeuble. S'ils n'ont pas trouvé de
termites au rez-de-chaussée, ils ne se donnent pas vraiment la peine de les
chercher au sixième étage, puisque, 99 fois sur 100, les termites remontent du
sous-sol... Quant aux peintures au plomb, elles sont en général noyées sous les
épaisseurs de papier peint et de peinture acrylique... Ce qui n'empêche pas les
hommes de l'art de facturer au prix fort une visite expresse, comme peuvent le
constater des milliers de vendeurs chaque semaine.
Chambres de commerce et d'industrie. Otez-nous d'un doute...
Combien des 33 000 personnes
employées par les chambres de commerce et d'industrie (CCI) en France
travaillent-elles vraiment ? A peu près la moitié..., ironise-t-on dans les
milieux socio-économiques. Il faut dire qu'avec 150 de ces établissements
consulaires, gérés par plus de 5 000 élus professionnels, et plus de 20
chambres régionales, la boursouflure du réseau est un sujet inépuisable de
blague. Certaines situations frisent la caricature : le Finistère compte 3
chambres, la Seine-Maritime en a 5, l'Aquitaine 8, le Nord-Pas-de-Calais 13.
Toutes financées par un impôt additionnel à la taxe professionnelle (ÏATP) dont
les entreprises s'acquittent de plus ou moins bon gré. Il est en effet de notoriété
publique que les CCI ne sont pas toujours des monstres d'efficacité. Le
gouvernement précédent les a très fortement incitées à se regrouper pour gagner
en nervosité et réaliser quelques économies d'échelle. Il a été entendu dans
les Vosges, la Somme, la Seine-et-Marne ou le Pas-de-Calais. Le
mouvement est en cours... Il en resterait quand même
130 en 2009. «
Nous coûtons de l'argent, admet Jean-François Bernardin, président de l'Assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI). Sommes-nous toujours utiles aux
entreprises ? Il est de notre devoir d'y réfléchir et d'évoluer en conséquence.
» Dont
acte»
Observatoires, hautes autorités... Le coût des comités Théodule

Petits ou gros, ils sont des
centaines. Il y a le Conseil consultatif national de la médiation familiale, le
Conseil national de la formation tout au long de la vie, l'Observatoire de la
pauvreté et de l'exclusion sociale, le Comité d'enquête sur le coût et le
rendement des services publics, la Commission générale de terminologie et de
néologie, un Observatoire de la vie sociétale (sic), un Observatoire de la
décentralisation, etc. Bien entendu, il est extrêmement difficile de prouver
que ces organismes sont inutiles. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, ils peuvent
rendre un service, émettre un rapport, donner un avis. Le tout est de savoir à
quel prix. Car chacun de ces comités Théodule a son président, son secrétaire
et ses administrateurs. Officiellement bénévoles, en réalité « indemnisés ». Et
pas toujours chichement.
La présidence du Haut Conseil de l'éducation rapporte 2
300 € par mois à son titulaire, celle du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance
maladie, 3 000 €. Une place de secrétaire général auprès du Conseil national du
tourisme vaut 3 820 € mensuels, alors que le président de la Commission
générale de terminologie et de néologie se contente de 821 €. Le record
appartient à la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et
pour l'égalité), dont le président, Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault,
touche 77 330 € par an. Au moins, on sait que cet organisme a déjà montré son
utilité sociale. Mais il y a quand même de quoi rire jaune devant la multitude
de ces commissions et hautes autorités en question, quand on sait que leur coût
pour les finances publiques se chiffre en millions d'euros annuels. Le tout
pour appliquer des lois et des règlements, ce qui est en principe la tâche de
l'Etat...»
UNE INTERVIEW D'OLIVIER
GODECHOT, CHERCHEUR AU CNRS*
Le «
trader » ou l'image du
voleur moderne
Avec leurs bonus faramineux, leur activité souvent
identifiée à de la pure spéculation, les traders, ces opérateurs de marché employés par les banques,
passent pour des mercenaires de la finance mondialisée, elle-même vue comme une
sangsue de l'« économie réelle ». Sont-ils utiles ? Peut-être. Leur
rémunération est-elle excessive ? Certainement.
Marianne : La figure du golden boy, du trader, s'est imposée quand on évoque
l'argent facile. Leurs rémunérations, via les bonus, font rêver... Olivier Godechot : Plus encore que celles des
PDG, dont le nombre restreint et la visibilité concentrent pourtant l'attention
des médias, la rémunération des traders fait fantasmer. Il y a un petit côté magique, une image
virile, western, de l'homme qui gagne beaucoup en « se battant seul » contre un
marché. L'envolée des activités de la finance et des rémunérations des «
travailleurs » de ce secteur n'a pu que renforcer cette image d'Epinal. Au
début des années 80, ces « working rich » voyaient dans un bonus de 1 million de dollars le but à
atteindre. Depuis la fin des années 90, c'est la dizaine de millions de dollars
qui est devenue leur horizon fantasmatique. Ont-ils conscience de la
déconnexion de ces niveaux de salaire ? Non, quand ils se comparent entre eux.
Ils sont alors prêts à défendre le moindre centime. Oui, quand, autour d'une
table, ils se comparent à leurs proches, famille, amis, extérieurs à la
finance.
Comment ces salariés ont-ils
réussi à imposer de telles conditions à leurs employeurs ?
O.G. : La culture du bonus s'est généralisée dans les années
80, d'abord dans le monde anglo-saxon, puis sur les autres places financières.
Le bonus est la carotte qui essaie de retenir dans un établissement ces
salariés hyper qualifiés, et souvent hyper volatils. Avant, dans le monde de la
finance dominé par les banques d'affaires, l'attachement des salariés était
assuré par l'espoir d'une promotion interne. L'objectif, à dix ou quinze ans,
de devenir associé dans un grand partnership, avec à la clé une belle rémunération, constituait un
bon motif de fidélisation. La démutualisation des partnerships, la montée en puissance des
activités financières, la multiplication des établissements financiers (grands
et petits), l'explosion des volumes d'argent génèrent une très forte
concurrence pour cette ressource cruciale : ces travailleurs qualifiés qui
portent et emportent de l'activité financière. C'est cette possibilité, très
inégalement distribuée, d'emporter avec soi l'activité financière, qui place
les traders,
les
vendeurs et plus encore leurs chefs d'équipe en situation favorable pour capturer
une grande partie des profits. C'est ainsi que, dans certaines activités, 40 %
des bénéfices d'une salle de marché sont redistribués entre les salariés comme
bonus.
Mais pour gagner plus, le
gâteau de la finance doit augmenter, lui aussi ? O.G. : Oui. Les activités de marché
sont très profitables, lucratives. Mais il n'y a aucune raison que cette
activité gagne structurellement plus que les autres secteurs. Les surprofits et
les sursalaires de ce secteur dessinent donc en creux l’inefficience des
marchés financiers. On parle depuis une dizaine d'années de dictature des
marchés financiers. L'idée qui tient la finance comme parasite de l'activité
des producteurs n'est pourtant pas neuve. Elle a, au moins, deux siècles.
Saint-Simon évoquait ainsi les frelons, la finance, qui spoliaient le travail
des abeilles, unité retrouvée des salariés et des entrepreneurs des secteurs
industriels. C'est au fond la vision d'Attac. Loin de moi l'idée de désigner la
finance comme un secteur voleur qui exploiterait les autres secteurs et qui
leur imposerait une volatilité démesurée qu'un hypothétique grain de sable (la
taxe Tobin) suffirait à supprimer. La finance a un rôle d'intermédiation utile
entre épargnants et investisseurs. En revanche, on peut poser la question du coût
de cette intermédiation. Coûte-telle trop cher ? Ma réponse est oui.
Cette rente du secteur de la finance est-elle réalisée
uniquement au détriment des autres secteurs de l'économie, donc des clients ?
|
|
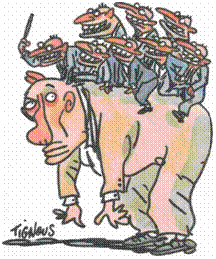 |
O.G. : C'est là une particularité de la finance et de
certains de ses salariés, trader, vendeurs et chefs de salle. En attachant à leur
personne tant les compétences, le savoir-faire, ce que l'on appelle le capital
humain, les clients, les équipes, ces working rich ont inversé à leur profit le processus de répartition
de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Toutes les autres composantes
sont mises à contribution pour sponsoriser les bonus. C'est vrai des autres
travailleurs comme des actionnaires. Il existe ainsi des mécanismes de
comptabilité qui masquent le coût d'une salle de marché et au contraire
augmentent la rentabilité apparente, et légitiment au final les rémunérations
des traders
et leur
pouvoir. On assiste du coup à une moins bonne rémunération des autres salariés
cantonnés dans les fonctions supports déconsidérées. Le pire, en tout cas pour
les actionnaires des établissements financiers, est que les managements sont
démunis face à un tel phénomène. Certes, les traders leur font gagner beaucoup
d'argent, mais ils pourraient en gagner beaucoup plus, si les bonus ne venaient
pas grever leur retour sur capital. Ces salariés des salles de marché «
exploitent » certes, en un sens aussi, d'autres salariés, mais dans la mesure où
ces travailleurs soumettent les capitalistes, ils peuvent aussi être vus,
paradoxalement, comme l'avant-garde du prolétariat...
Quels sont les effets de
l'émergence de cette nouvelle aristocratie salariale ? O.G. : Ils sont très nombreux. Dont
deux, à mon sens, très importants. Les working rich font pression pour faire baisser les impôts. Le rabot
fiscal est le meilleur moyen pour redistribuer la rente capturée par les
professionnels de la finance. Or, on va dans le sens inverse. En France, un trader gagnant 2 millions d'euros en
conserve aujourd'hui 54 % contre 40 % en 2002. Second effet : l'accumulation
rapide de richesse contribue à son tour à l'envolée des actifs, notamment
immobiliers. A Paris et plus encore à Londres, le prix des appartements a explosé,
en partie en raison de l'opulence des activités financières • Propos recueillis par Emmanuel
Lévy *
Olivier Godechot est chercheur au CNRS (centre Maurice Halbwachs) et
sociologue. Dernier ouvrage paru : Working Rich : salaires, bonus et appropriation du
profit dans l'industrie financière, ta Découverte, 306 p., 25 €.
Agents artistiques. De juteuses coulisses
Qui connaît Artmedia ? Une société créée en 1972 par
Gérard Lebovici. Personnage flamboyant des années 70, éditeur, producteur,
l'homme révèle un flair remarquable. Il produit des films d'Alain Resnais, de
François Truffaut, d'Eric Rohmer, crée les éditions Champ libre, se lie avec
Guy Debord, pape du situationnisme et auteur de la Société du spectacle. En 1965, il rachète l'agence
artistique d'André Berheim, puis absorbe l'agence Cimura, qui a sous contrat
Belmondo. Artmedia naît de ces fusions. En 1982, il monte la société de
production AAA (Acteurs auteurs associés). Ces multiples activités lui
permettent de lancer Dewaere, Coluche, Miou-Miou, Jacques Villeret, etc. Son
amitié avec Debord lui vaut brouilles, polémiques, insultes publiques. Le
personnage a sa part d'ombre, celle de sa fascination pour l'ultragauche et le
grand banditisme. Il prendra sous son aile protectrice Sabrina Mesrine, la
fille de Jacques, ennemi public numéro un, tué par la police en 1979. En 1984,
« Lebo » est abattu de quatre balles dans la nuque dans un parking de l'avenue
Foch à Paris. Ses assassins n'ont jamais été identifiés. Artmedia représente
aujourd'hui plus de 600 talents dans tous les métiers du cinéma et du
spectacle, dont Audrey Tautou et Guillaume Canet pour citer les plus récents
entrés dans son portefeuille. Bien d'autres sociétés d'agents existent :
Adéquat, Zelig Intertalents, Act 1... de très grosses structures, mais aussi
des toutes petites. Pour le monde
des acteurs, ce sont les noms qui comptent, pas les
raisons sociales : David Vatinet, François Samuelson, Juanita Fellag,
Jean-François Gabard, Elisabeth Tanner, Eric Altmeyer, Dominique Besnehard...
des gens supposés faire les carrières. Ceux-là sont parmi les plus connus, donc
les plus efficaces. Mais pour un Lebovici découvreur d'immenses talents,
combien d'intermédiaires plus ou moins parasites naviguant entre production,
agences de castings, acteurs en mal de rôles, mais percevant toujours leurs 10
% ou plus de commission sur les contrats passés ? Est-ce l'agent qui fait la
carrière de l'acteur ? Ou est-ce le talent de ce dernier, son envie d'élargir
la palette des personnages interprétés, qui le rend inévitable ? Après tout,
c'est le public qui fait le succès... donc le nombre de zéro au bas du contrat.
Un agent, au mieux, peut aider à la réalisation d'un projet. Il peut exercer une
influence ou tenter de le faire, jamais prendre une décision à la place d'un
producteur, d'un metteur en scène, d'un scénariste... et d'un acteur. Certains
peuvent envoyer des scénarios à leurs clients... qui peuvent les refuser.
D'autres peuvent conseiller un rôle... qui ne sera pas accepté ; susurrer le
nom d'un comédien... qui ne sera pas pris. D'ailleurs l'agent est-il celui du
producteur ou de l'acteur ? N'y a-t-il pas risque permanent de conflit
d'intérêt ? Les grosses structures et leurs juristes ont leurs avantages. Elles
peuvent, lors de l'élaboration des contrats, en contrôler avantageusement les
clauses, défendre les droits des auteurs, sur tous les produits dérivés d'un
film, par exemple. Les indépendants, eux, se veulent plus proches de leur vedette
et prétendent entretenir avec elle une relation plus confiante. Il arrive,
heureusement, qu'une star accepte un cachet ridicule juste par envie de tourner
avec tel metteur en scène. Dès lors, à quoi sert l'agent ? Depuis vingt-cinq
ans, Thierry Lhermitte s'en passe. Il prétend parler d'argent tout seul, comme
un grand. Après tout, un contrat, dit-il, « il suffit de regarder le
montant, et la date » •
Et si les directions générales ne servaient plus à
rien ?
|
|
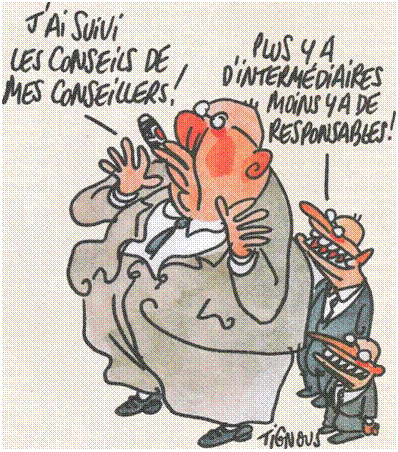 |
Les directions des grands groupes sont-elles des
parasites ? La question peut sembler absurdement provocatrice, mais à bien y
réfléchir... La plupart des multinationales d'aujourd'hui sont organisées en
unités de production assez largement autonomes. Nombre d'usines Renault ou PSA,
par exemple, sont des sociétés anonymes à part entière. Ces centres de
production sont regroupés en zones géographiques ou sectorielles (poids lourds
ou véhicules de tourisme, pour rester dans le secteur automobile). Et c'est
seulement au-dessus de cet appareil productif que vient se greffer une
direction générale, souvent organisée en holding et parfois étonnamment resserrée
: quelques centaines de cadres dits « supérieurs » dirigent des effectifs qui
se chiffrent en dizaines de milliers de salariés. Encore faut-il préciser ce
qu'on entend par diriger. II n'est plus vraiment question à ce niveau de mettre
les mains dans le cambouis, de discuter avec le CHSCT (comité d'hygiène, de
sécurité, et des conditions de travail) du capot de protection de la meuleuse
n° 7 de l'atelier d'ébarbage ! Il s'agit de penser stratégie, long terme,
développement. Et c'est à ce stade qu'on en vient à la notion de parasitisme.
Car de quoi s'occupent les directions générales d'aujourd'hui ? Essentiellement
de fusions et de rachats. Ce qui devrait être l'exception dans la vie des
entreprises est devenu la norme, le quotidien. La direction de la Société
générale pense à racheter BNP-Paribas. La direction de Wal-Mart pense à
racheter Carrefour. La direction de LVMH étudie le rachat des Echos. La direction de Pepsico repense
sans doute à Danone. Ces fusions-acquisitions ne sont pas une mince affaire.
Elles accaparent des milliers d'heures de travail, sans compter les honoraires
astronomiques des banques-conseils et des cabinets d'audit. Les préparatifs
durent des mois, parfois des années. Et, six ou sept fois sur dix, la fusion
est un échec. C'est ce qui ressortait d'une étude restée célèbre du cabinet
A.T. Kearney en 1999, que rien n'est venu démentir entre-temps. Certains ont le
courage de l'avouer, comme Daimler, qui a décidé en mai dernier de revendre
Chrysler neuf années seulement après l'avoir acheté. Autant dire que certains
cadres du groupe allemand sont passés quasiment sans transition de la
préparation du mariage à celle du divorce ! A coups de
synergies, d'optimisations et d'effets de taille
critique, 1 + 1 devait faire 3. A l'arrivée, Daimler a perdu près de 4 milliards
d'euros dans l'affaire. D'autres s'entêtent, comme les dirigeants de Safran.
Issu du mariage catastrophique de deux entreprises qui n'avaient pas
grand-chose à mettre en commun, l'électronicien Sagem et le motoriste Snecma,
ce groupe mal né et mal bâti tourne depuis des mois grâce à d'exceptionnelles
équipes d'ingénieurs soudées par la passion de leur métier, pendant qu'au
sommet ses « patrons » se déchirent, à la recherche d'une introuvable stratégie
d'ensemble. Aux dernières nouvelles, ils réfléchissaient d'ailleurs à une...
fusion avec Thaïes. Pour les dirigeants, les enjeux sont cruciaux, puisqu'il
s'agit de savoir qui contrôlera le nouvel ensemble. Mais pour l'entreprise ? « Chez nous, explique un cadre de
BNP-Paribas, beaucoup
se demandent à quoi a servi la fusion. Sept ans après le rapprochement, il y a
toujours le clan des ex-Paribas, celui des ex-BNP et les deux se tirent dans
les pattes. » Idem au sein du nouvel ensemble
Crédit agricole-Crédit lyonnais ou encore dans la pharmacie. Les professionnels
sont unanimes à considérer que les rapprochements effrénés des années 90 ont
freiné les progrès dans le médicament plus qu'ils ne les ont accélérés.
Aujourd'hui, ces mastodontes qu'on appelle les « big pharma » achètent l'innovation là où
elle se trouve : dans des petites sociétés de biotechnologie. La situation
frôle parfois le cocasse. Sanofi-Aventis, par exemple, a essuyé mi-juin un
revers cinglant, avec le rejet par les autorités américaines d'une pilule anti
obésité présumée miracle, Acomplia. Voilà des années que l'organisation du
groupe est chamboulée par des rapprochements en cascade, ce qui ne crée
peut-être pas des conditions de travail optimales pour des projets à long
terme. Et pourtant, à l'annonce du rejet, un des premiers réflexes de la
direction a été de relancer l'idée d'une fusion avec un autre laboratoire,
Bristol-Myers Squibb. Incorrigible •
La copropriété, c'est le vol
Il a bien fallu que le
ministère I
de
l'Economie s'en mêle. Au début du mois de juin, la DGCCRF (Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a
annoncé par un communiqué l'existence d'un rapport calamiteux sur les syndics
de copropriété. Il est vrai que ses agents croulaient sous les plaintes. Une
vaste enquête a donc été décidée portant sur 250 syndicats de copropriété
répartis dans 44 départements pour 12000 copropriétaires. Les résultats sont
consternants : 50 rappels à la réglementation (un sur cinq des syndicats
contrôlés), cinq procès-verbaux pour défaut d'affichage des prix et publicité
trompeuse, et deux rapports transmis au parquet (donc des affaires susceptibles
de sanctions judiciaires civiles ou pénales). Les enquêteurs de la DGCCRF ont
noté des «
prestations particulières facturées en sus des honoraires de gestion courante
», le « maintien de clauses abusives
dans les contrats », l'« absence de mise en concurrence des entreprises pour
des travaux d'entretien ou de rénovation », etc. Le communiqué n'en dit pas
plus et l'intégralité du rapport n'a hélas pas été rendue publique. Mais de
graves délits auraient été découverts. Un « consortium » de syndics n'aurait
rien trouvé de mieux que d'acheter du fioul pour le revendre avec plus-values à
leurs copropriétés clientes. Ces magouilles auraient de beaux jours devant
elles si l'on considère que la copropriété concerne 7,6 millions de logements
en France et que ce mode de gestion croît plus vite que la location ou la
propriété simple. Bien entendu, l'ARC (Association des responsables de
copropriété) a poussé des cris et réclamé une réglementation car les syndics,
selon elle, sont incapables de « s'empêcher de créer chaque jour de nouveaux
honoraires supplémentaires ». Depuis 2006, le législateur a imposé les mêmes
règles de comptabilité aux syndics. Mais rien n'y fait. Les histoires de
syndics défraient la chronique judiciaire depuis belle lurette. Même si
certains sont honnêtes, la profession paraît sérieusement gangrenée.
D'ailleurs l'ARC, dès 2003,
s'était retirée du comité de certification du label « qualité syndic ». Après
trois ans de négociations, les représentants des syndics ne voulaient toujours
pas entendre parler de sanctions pour ceux d'entre eux qui n'auraient pas
respecté les obligations liées à l'obtention du label. Une vraie farce. Et que
dire de ce procès ouvert en septembre 2005 devant le tribunal correctionnel de
Paris où comparaissaient le gérant et son associé du cabinet de syndic
Immobilière Europe ? Ils avaient perçu, via une société écran, 2 milliards de francs d'honoraires
des entreprises auxquelles ils avaient confié des travaux dans les copropriétés
dont ils avaient la charge. Des commissions en forme de pots-de-vin. La
pratique est hélas extrêmement répandue. En fait, toute l'Ile-de-France était
touchée ; 37 cabinets de syndics de la région avaient reçu, de la part de 786
fournisseurs, 7,6 millions d'euros. Ce qui faisait dire au ministre du Logement
de l'époque qu'il n'y aurait pas assez de places au Zénith pour accueillir tous
les syndics mis en examen. Et depuis, ça a changé ? Rien n'est moins sûr...
![]() Les « coachs». Payez votre manque de
confiance en vous
Les « coachs». Payez votre manque de
confiance en vous